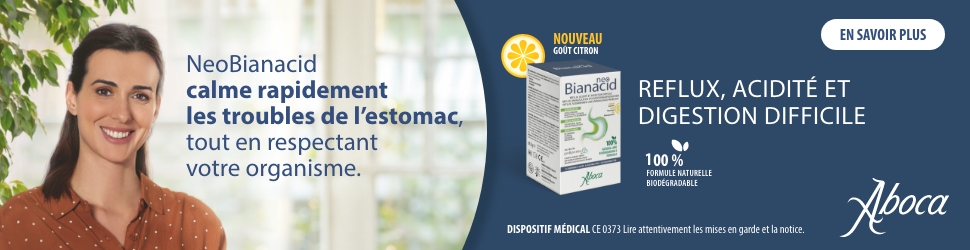Les méningites

Si l'ensemble des méningites sont des urgences diagnostiques et thérapeutiques, c'est surtout le cas pour celles qui sont dues à une bactérie. " Dans leur cas, chaque minute compte ", explique la professeure Leïla Belkhir (UCLouvain) lors des Journées BTMS 2023 consacrées à la neurologie.
Certes, les méningites virales (MV) représentent la forme la plus fréquente de méningites (70 à 80% des cas, majoritairement par entérovirus). Quant à l'incidence des méningites bactériennes (MB), elle a heureusement baissé significativement dans le monde grâce à la vaccination contre l'Haemophilus influenzae B, le méningocoque de type C et le pneumocoque (PPV et PCV). Cependant, au vu de leur gravité, il faut considérer a priori toute méningite comme étant de cause bactérienne, jusqu'à preuve du contraire.
La prise en charge de cette urgence vitale doit être très rapide afin de permettre l'administration de l'antibiothérapie dans les plus brefs délais: à titre d'illustration, le risque de décès à trois mois est multiplié environ par 15 lorsque l'antibiothérapie n'est initiée qu'après 3 heures. Outre d'améliorer la survie, la prise en charge rapide permettra de diminuer le risque de complications comme la surdité, les déficits neurologiques, les troubles cognitifs et les conséquences d'un sepsis.
Pneumocoque et méningocoque, les principales bactéries responsables
En ce qui concerne la physiopathologie, on retiendra que l'infection méningée trouve sa source:
? Dans une bactériémie/une virémie provenant généralement d'un foyer pharyngé (pneumocoque, méningocoque, Haemophilus) ou digestif (Listeria),
? Ou dans une infection/une contamination de contiguïté (otite ou sinusite, simple portage asymptomatique, ou brèche traumatique/postopératoire).
L'étiologie des MB varie en fonction de l'âge et des comorbidités. Le pneumocoque et le méningocoque sont à eux seuls responsables d'environ 80% de ces méningites. Par ailleurs, la méningite par Haemophilus influenzae B est rare chez les personnes âgées.
Plus précisément, les MB sont généralement dues:
? Chez l'enfant à partir d'un mois et jusqu'à la fin de l'adolescence: surtout au méningocoque (principalement de type B), au pneumocoque et à H. influenzae B (ce dernier devenant de plus en plus rare grâce au vaccin),
? Chez l'adulte, en ordre de fréquence décroissant: pneumocoque, méningocoque, streptocoque du groupe B et Listeria.
Des facteurs de risques très variés...
Les méningites à méningocoque sont particulièrement fréquentes dans une partie de l'Afrique, au point qu'on parle d'une "ceinture méningée" devant inciter les voyageurs à se faire vacciner lorsqu'ils y voyagent dans certaines conditions. En Belgique, la prévalence de ce type de méningite est stable depuis 2008, avec environ 100 cas/an. Les derniers chiffres disponibles (2021) montrent que le sérogroupe B reste dominant (62,5%), tandis que celle du sérogoupe Y chute (4,1%) et que celle du sérogroupe W augmente (29,2%). Au total, ces deux derniers groupes représentaient un tiers des cas en 2021 [1].
Le risque de décès à trois mois est multiplié environ par 15 lorsque l'antibiothérapie n'est initiée qu'après 3 heures.
Les méningites à pneumocoque ont souvent un début très brutal. Parmi les facteurs de risque, on cite notamment les infections ORL, l'éthylisme chronique, le diabète, la splénectomie et l'âge élevé.
Quant aux méningites à Listeria monocytogenes, elles touchent principalement des personnes âgées (> 60 ans), des femmes enceintes, des diabétiques et des personnes immunodéprimées ou sous corticoïdes.
Enfin, les méningites à H. influenzae B peuvent principalement s'observer chez les enfants de moins de cinq ans (mais la vaccination a fortement amélioré la situation), les éthyliques, les diabétiques et les patients souffrant d'un myélome multiple.
... tout comme la symptomatologie
Les signes évoquant un syndrome méningé sont:
? La fièvre,
? Une raideur de nuque,
? Des céphalées intenses, aggravées par l'exposition au bruit (phonophobie) et à la lumière (photophobie),
? Des vomissements spontanés, en jets.
La raideur méningée est douloureuse et permanente, avec une contracture musculaire qui limite l'antéflexion de la tête. Elle peut également être démontrée en position couchée:
? Par le signe de Kernig, qui se recherche en position couchée, en fléchissant à 90° la cuisse sur le bassin, avec une résistance douloureuse à l'extension de la jambe dans cette position,
? Par le signe de Brudzinski, en imprimant une antéflexion de la tête et en observant alors une flexion réflexe des membres inférieurs.
Les méningites peuvent également s'accompagner de:
? Une altération de la conscience,
? Un rash cutané et des pétéchies (dans respectivement 63% et 89% des méningites à méningocoques),
? Un choc septique (10 à 25% des cas),
? Un syndrome viral, des symptômes digestifs (entérovirus), une parotidite, voire un herpès génital.
Cela étant dit, prudence car "une méningite bactérienne de l'adulte ne peut être exclue par l'absence des symptômes et signes classiques", explique la Pre Belkhir. "En cas de suspicion clinique, il faut réaliser une ponction lombaire pour exclure le diagnostic."
La ponction lombaire (PL) diagnostique doit donc être réalisée en urgence (précédée éventuellement d'un scanner cérébral en cas, entre autres, de crises épileptiques, de signes de focalisation neurologique ou de troubles de la conscience). Si la mise au point diagnostique ne peut être réalisée dans l'heure de l'admission du patient, l'antibiothérapie probabiliste sera débutée avant la PL.
Ce que peut révéler la ponction lombaire
Le prélèvement de liquide céphalo-rachidien permet de confirmer le diagnostic par différentes analyses (biochimiques, cytologiques, microbiologiques). Une fois prélevés, les tubes sont à déposer en urgence au laboratoire. Les contrindications à la réalisation d'une PL comprennent un risque accru de saignement (traitement anticoagulant ou thrombopénie < 50.000/mm3), des signes évoquant une possible hypertension intracrânienne, une détérioration neurologique rapide, un choc septique/une coagulation intraveineuse disséminée, un purpura ou une immunodépression sévère. Idéalement, les résultats de la PL devront parvenir dans l'heure, montrant la cytologie, la biochimie et une coloration de Gram.
La biochimie comprendra la protéinorachie (> 200 mg/dl en cas de MB), la glucorachie (< 40 mg/dL en cas de MB, ou moins de 40% de la glycémie) et le taux d'acide lactique (souvent > 3 mmol/L en cas de MB). Le taux de leucocytes s'élèvera généralement à 100-10.000/mm3 en cas de MB, avec une prédominance neutrophilique, une coloration de Gram positive dans 70 à 90% des cas et une culture positive dans environ 80% des cas. En présence d'une MV, la PL montrera plutôt des lymphocytes, une glucorachie et un taux d'acide lactique normaux, une protéinorachie augmentée et, bien entendu, une coloration de Gram et une culture bactérienne négative.
À noter que la PCR représente un progrès important dans le diagnostic des méningites infectieuses: en une heure environ, elle permet d'identifier de nombreux agents infectieux, tant des bactéries que des virus ou des cryptocoques.
Antibiothérapie et dexaméthasone
Le traitement empirique d'une méningite communautaire, chez des personnes âgées d'au moins 16 ans et qui ne présentent pas de facteur de risque particulier, se basera sur la ceftriaxone +/- amoxicilline (contre Listeria). Le méropénem +/- cotrimoxazole peut être envisagé en cas d'allergie. Quant à la durée de cette antibiothérapie, les guidelines actuelles recommandent 10 à 14 jours pour le pneumocoque, 7 jours pour le méningocoque, 7 à 10 jours pour l'H. influenzae, minimum 21 jours pour la listériose et un minimum de 14 jours en cas de culture négative.
Il est également important d'administrer des corticoïdes (idéalement) avant la première dose d'antibiotiques, car c'est la réponse inflammatoire qui est surtout responsable des complications et du risque de décès. Cet état inflammatoire est d'ailleurs encore transitoirement accru par la lyse bactérienne induite par les antibiotiques. Dans ce contexte, l'administration a priori contrintuitive de dexaméthasone est bénéfique, surtout si l'agent infectieux est un pneumocoque. La poursuite du traitement par dexaméthasone sera déterminée par la nature du germe détecté par la ponction lombaire.
Les méningites virales: penser surtout au virus herpétique
D'installation aiguë, leur présentation semble généralement bénigne, avec un état de conscience normal et l'absence de signe de focalisation. De même, la biologie sanguine se révèle la plupart du temps relativement normale, avec un syndrome inflammatoire modéré. Il faut penser principalement aux entérovirus, à herpès simplex en cas d'infection génitale, à herpès zoster en cas de zona, et au VIH. Le LCR sera de type eau de roche, non purulent, avec une glycorachie normale.
Si la plupart des MV sont d'évolution spontanément favorable, il est important de traiter rapidement par aciclovir toute méningite ou méningo-encéphalite suspecte d'être d'origine herpétique.
[1] https://www.sciensano.be/sites/default/files/surveillance_epidemiologique_des_infections_invasives_a_meningocoque_-_donnees_2021.pdf
Le purpura fulminans ou l'urgence absolue
Comme il entraîne jusqu'à 20-30% de mortalité en plus de nécroses des extrémités, le purpura fulminans, dès son observation au domicile du patient, impose d'injecter de la ceftriaxone avant même le transfert en ambulance.
Quid pour les cas contacts?
Il n'est pas utile de prescrire systématiquement une antibiothérapie pour tous les cas contacts d'un patient porteur d'une méningite: elle ne peut contaminer un hôte susceptible que s'il s'agit du méningocoque ou d'Haemophilus influenzae, au travers de gouttelettes. Les cas contacts (réellement) proches se verront idéalement prescrire rapidement une antibiothérapie, pendant une durée allant jusqu'à 7 jours. Cette antibiothérapie peut prendre la forme de ciprofloxacine ou d'azithromycine en dose unique, ou de rifampicine pendant deux jours.
Référence: https://matra.sciensano.be/Fiches/Meningo.pdf, pages 14 et 15
Objectifs d'apprentissage
La lecture de cet article vous aura familiarisé(e) avec:
- La prévalence et la dangerosité des méningites virales versus bactériennes ;
- Les principales bactéries responsables de méningite ;
- Les facteurs de risque liés aux différentes bactéries responsables de méningite ;
- La symptomatologie de la méningite ;
- Les anomalies détectées dans le LCR en cas de méningite bactérienne versus virale ;
- L'antibiothérapie empirique à administrer en cas de méningite communautaire ;
- Les principaux virus responsables de méningites ;
- La protection des contacts.