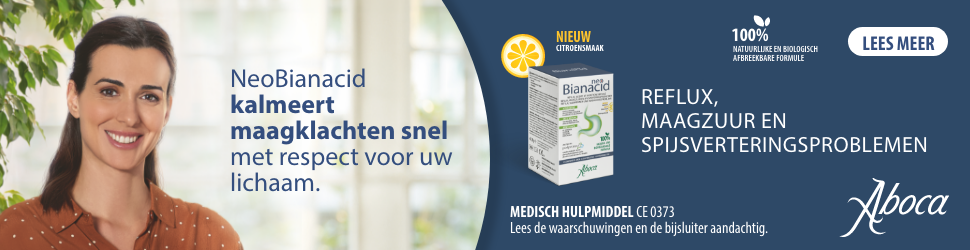Du comptoir au sous-bois
Le pharmacien « fou de champignons »

À la croisée de l’univers de la pharmacie et de celui de la mycologie, le témoignage d’un homme formé à l’un et passionné par l’autre éclaire la pratique des pharmaciens confrontés aux questions de cueillettes, de toxicité et d’éducation du public.
Pharmacien d’officine, Luc Crutzen enfile souvent une autre casquette, celle de mycologue passionné. À ses heures libres, il parcourt les bois, observe, identifie et photographie. Il est pourtant loin le temps où il était de tradition de porter ses cueillettes chez le pharmacien pour valider l’identification des espèces comestibles. « À l’université, on avait bien un volet 'mycologie' dans le cours de botanique et pharmacognosie, mais c’était abordé très légèrement et très rapidement ; on avait quelques TP à l’époque, mais je ne pense pas qu’ils existent encore », évoque celui qui gère, avec son épouse, la pharmacie du Blocry à Louvain-la-Neuve. « Aujourd’hui, à moins d’avoir fait un cursus universitaire supplémentaire, la formation de base ne permet plus aux pharmaciens d’être à l’aise avec ça. »
La responsabilité reste au consommateur

Dans sa pratique à l’officine, Luc Crutzen est parfois sollicité, car ses proches patients connaissent son intérêt pour le sujet. « De temps en temps, en automne, des gens viennent avec un champignon ou l’autre, et je leur donne un avis », indique-t-il avec prudence en rappelant certaines limites de l’exercice. « Parfois, il faut savoir sous quel arbre le champignon a poussé. Quand on m’amène le tout dans un sachet, tous les uns sur les autres, c’est parfois abîmé… or, il faut tous les éléments. Enfin, je valide parfois le champignon qui arrive ici, mais on je ne sais jamais ce qu’on a laissé à côté. La responsabilité finale, elle est toujours au consommateur. »
À ses yeux, le pharmacien n’a pas vocation à remplacer un mycologue diplômé, mais il peut orienter : « Il ne faut jamais s’engager quand on n’est pas sûr. Le centre antipoison reste une référence en cas d'intoxication, mais même eux font appel à des mycologues. » Il trouve un bel équilibre en Suisse. « Là-bas, il y a la Vapko, une association qui propose des contrôles de cueillette. Ce ne sont pas nécessairement des pharmaciens, mais des mycologues diplômés qui valident les cueillettes. Le dimanche, on peut amener son panier et ils font le tri : ‘ça c’est bon, ça tu jettes’. »
Des sentiers aux réseaux sociaux

Sa passion pour la mycologie, Luc Crutzen la vit à la fois dans la solitude des bois et dans la communauté des réseaux sociaux, d’où il tire une partie de ses connaissances. « C’est avant tout beaucoup de bouquins et un Mooc de l’Université de Rouen, mais aussi des groupes Facebook… en plus du terrain, évidemment. Il faut avoir un champignon en main plusieurs fois pour pouvoir l’identifier avec un peu de certitude. » Respectivement administrateur et modérateur d’un groupe belge et d’un groupe français, en saison, en équipe, ils voient parfois défiler plusieurs centaines de demandes par jour, auxquelles il répond toujours selon le même mantra : « Jamais de l’intuition ! C’est de la science. Il faut vérifier des critères visuels. »
Et puis, il y a enfin Instagram, où il publie toutes les photos de ses trouvailles sous le pseudo @le_fou_de_champignons (en trois mouvements de pouce, le crochet virtuel vaut le détour), référence à l’Essai sur le fou de champignons du Prix Nobel de littérature autrichien Peter Handke. Il s’y est mis en 2019 sur invitation de sa sœur et d’un garde forestier impressionné par ses photos. Luc Crutzen revendique une ligne éditoriale simple : « Pas pour éduquer, mais pour le plaisir visuel… même s’il m’arrive de joindre des anecdotes, des visuels explicatifs », détaille-t-il avant de lâcher en souriant : « J’ai quasi 1.000 followers ; ma fille est jalouse… »

Les réseaux sont aussi des lieux d’alerte. Il raconte avoir évité un accident : « Un jour, un gars que je ne connaissais pas publiait sur un groupe Facebook une photo de sa cueillette et annonçait une poêlée de girolles. J’ai vu effectivement beaucoup de girolles… et un autre champignon, très ressemblant, mais toxique, le genre qui vous envoie rapidement à l’hôpital. Je l’ai appelé : ‘Arrête tout de suite !’. Heureusement, le pire a pu être évité. »
Distinguer l’arbre du fruit
Pédagogue, le néolouvaniste parle aux néophytes de sa passion en jonglant avec les images et les anecdotes. « Le champignon que vous voyez, c’est comme un fruit. L’'arbre', lui, est souterrain : c’est le mycélium. Sur un hectare, il peut y avoir dix tonnes de mycélium. Le plus grand champignon connu est aussi le plus grand être vivant du monde. Il fait dix km², a 2 000 à 8 000 ans ; les carpophores visibles (les « fruits », ce que à quoi le grand public réduit souvent le terme de ‘champignon’) réunis pèsent la masse d’un cachalot. Il est en Oregon. »
Côté alimentation, il distingue les comestibles non cultivables, qui dépendent du bon vouloir de la nature et dont les plus emblématiques sont les cèpes, les truffes et les girolles, de ceux qu’on cultive : champignon de Paris, shiitaké, pleurotes… D’autres, au rayon des levures, donnent le pain, le vin, la bière et le fromage. Enfin, moins connu : « La production de l’acide citrique des boissons dites ‘softs’, c’est aussi réalisé à l'aide de champignons. »
De la mycologie à l’écologie

Au-delà des critères, la mycologie a eu un impact sur son regard envers la nature. « La mycologie amène à l’écologie », soulève-t-il. « J’ai appris à reconnaître les arbres parce que, par exemple, sous un hêtre, on ne trouve pas la même chose que sous un chêne. J’ai aussi compris à quel point le sol est habité. »
Il confie enfin que, s'il en avait le temps, il suivrait bien le diplôme universitaire de mycologie à Lille. Pour l’heure, il va continuer à partager son émerveillement sur les réseaux, en gardant cette profonde humilité qu’on perçoit chez lui sans équivoque : « on peut être non scientifique et connaître les champignons mieux que moi. C’est accessible à tout le monde, pour peu qu’on travaille des années. »

Six conseils de l'expert
Interrogé, Luc Crutzen déroule un petit vade-mecum utile à pouvoir ressortir au comptoir :
- Photographier la cueillette avant de cuisiner : « En cas de problème, les vomissures, c’est compliqué ; les photos, c’est beaucoup mieux. »
- Ne manger que des espèces formellement identifiées : « Pas de jeunes exemplaires : ils se confondent. Pas de vieux non plus : ils se dégradent, comme une pomme. »
- Refuser les spécimens véreux ou altérés : « Certains mangent un cèpe plein de vers ; c’est non ! Il y a de la cadavérine, des risques d’intoxication alimentaire. »
- Rester modéré : « Ce sont des condiments : pas un demi kilo tous les jours pendant une semaine. Ils contiennent de la chitine, qui est indigeste. »
- Se méfier des applis : « Si c’est relativement précis pour les arbres et les plantes, c’est très souvent à côté de la plaque pour les champignons. »
- Établir un réseau local : « Avoir quelques noms, un laboratoire, un cercle mycologique, et orienter dès que nécessaire. »
- Toujours bien cuire les champignons, sauf exception.
Pour l’officine, il met enfin en garde sur la responsabilité et le temps : « On n’est ni payé pour ça, ni formé, ni assuré. Moi, je le fais entre deux patients, par passion. »

Anecdote mycologique
La sonorité des Stradivarius tient à un bois d’érable et d’épicéa, à cernes fins, issu de croissances lentes du « petit âge glaciaire » (1645-1715), irréplicables à cause du réchauffement climatique. En 1992, Francis Schwarze montre que certains champignons amincissent les parois cellulaires du bois sans dégrader l’acoustique. Par infection contrôlée, on obtient un « mycobois ». En 2009, des violons fabriqués avec ce bois ont égalé un Stradivarius de 1711 aux oreilles des experts. La lutherie devient alors plus accessible.